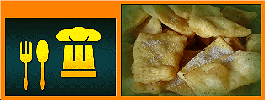Milh e milhòc - Millet et maïs
 LO MILH
LO MILH
Lo medic deu noste Enric, lo Jausèp du Chesne, hens lo son libe "le pourtraict de la santé" que remarcava qu'au païs de Bearn e quauques lòcs deu Haut Armanhac, lo pan de milh qu'èra comun. En aqueth temps, per la campanha, ne's minjava pas hèra de carn e
lo milh (o panic) qu'èra la basa de l'alimentacion. Mesclat a l'aiga o a la lèit, que'n hasèn pastas de har còser suu huec de la chemineia o boridas. Segon lo lòc, que poden estar "milha", "milhar", "milhada", "mica", "brasairas"... L'alimentacion que'n èra un drin tròp desequilibrada e los gascons que sofrivan de pellagra.
 Pan de milh :
Pan de milh :
Har moler lo milh. Hicar 5 a 6 litres d'aiga dab 2 kg de haria e un drin de sau. Mesclar de plan, puish hicar a borir hens la cautèra dinc a har lhèvar la pasta. Tornejar dab un baston. A la fin la pasta que'n serà copadissa. Hicar tròç de pasta hens assietas e deishà'us durcir.

 LO MILHÒC
LO MILHÒCA la fin deu sègle XVIIIau, lo milhòc qu'a pres la plaça deu milh. A Ortès, que'n hèn la mestura. Borida, la pasta de milhòc que balha la bròja. Picamilh (plan nomat ací !), en 1858, hens las "Statistiques générales des Basses-Pyrénées", que ditz :
« La sobriété [du Béarnais] est extrême : il consomme peu de pain, remplaçant cet aliment par la broye, sorte de bouillie faite avec de la farine de maïs délayée dans du lait ou plus souvent dans de l'eau." En Vath d'Aussau, que s'i hasè pan dab mieitat de haria de hroment e mieitat de balharc, hèra mei leugèr que la mestura o pan de milhòc.»
La "mestura" que s'apèra tanben "cruchada" o "escauton". Las recèptas que son a chic de causa, las medishas que la deu pan de milh. Entà consumir aquestes pans, que poden tanben passar lescas hens haria e las har fríser tà las minjar dab salat o sucrat.
> A léger :« Alimentation et cuisine en Béarn » (ABC, 1984)
 LE MILLET
LE MILLET
Le médecin d'Henri IV, Joseph du Chesne, dans son livre "le pourtraict de la santé" remarquait qu'au pays de Béarn et quelques lieux du Haut Armagnac, le pain de millet était commun.
En ce temps-là, par la campagne, on ne mangeait pas beaucoup de viande et le millet était la base de l'alimentation. Mêlé à l'eau ou au lait, on en faisait des pâtes à faire cuire sur le feu de la cheminée ou bouillies. Selon le lieu, ce pouvait être "la mille", "le millas", "la millade", "la mique", "les brasayres"... L'alimentation en était un peu trop déséquilibrée et les gascons souffraient de pellagre.
 Pain de millet :
Pain de millet :
Faire moudre le millet. Mettre 5 à 6 litres d'eau avec 2 kg de farine et un peu de sel. Bien mélanger, puis mettre à bouillir dans la chaudière jusqu'à faire lever la pâte. Tourner avec un bâton. A la fin la pâte sera cassante. Mettre des morceaux de pâte dans des assiettes et les laisser durcir.
 LE MAÏS
LE MAÏS
A la fin du XVIIIe siècle, le maïs a pris la place du millet. A Orthez, on en fait la méture. Bouillie, la pâte de maïs donne "la broye". Picamilh, en 1858, dans les "Statistiques générales des Basses-Pyrénées", dit :
« La sobriété [du Béarnais] est extrême : il consomme peu de pain, remplaçant cet aliment par la broye, sorte de bouillie faite avec de la farine de maïs délayée dans du lait ou plus souvent dans de l'eau.» En Vallée d'Ossau, on faisait du pain avec moitié de farine de froment et moitié d'orge, beaucoup plus léger que la méture ou pain de maïs.

La "méture" s'appelle aussi "cruchade" ou "escautou". Les recettes sont à peu de choses près, les mêmes que celle du pain de millet. Pour consommer ces pains, on peut aussi passer des tranches dans la farine et les faire frire pour les manger avec du salé ou du sucré.
> A lire : « Alimentation et cuisine en Béarn » (ABC, 1984)
Lo milhòc en Biarn - Le maïs en Béarn
Lo milhòc sembla ser estat domesticat que hè 9 000 ans hens la Sierra Madre del Sur, au Sud de Mexicò. Qu'arriba en Europa au s. XVIau. Dab los conquistadors, e qu'ei plantat en purmèr hens la region andalosa. Gràcias a las analisis geneticas, qu'an determinat que lo milhòc cultivat de la Galicia aus Pirinèus e vien d’ua combinason deus milhòcs d’America deu Sud e deu Nòrd. Qu'ei amiat hens lo Sud-Oest peus pòrts de Baiona e Bordèu (Qu'ei mencionat a Baiona en 1523 e a Monenh en 1675).
Chic utilizat au s. XVIau, la cultura soa s'espandeish au sègle qui segueish e arriba a l'apogèu son de cap a 1850. Qu'aucupan lavetz 650 000 ha en França e, com ac confirma l’intendent d’Etigny, lo milhòc biarnés qu'ei exportat peu pòrt deu Sompòrt, en Espanha e au Portugau. Hens las Lanas e los Pirinèus-Baishs, las susfàcias doblan de 1800 a 1850 e lo segle, lo milh, lo sarrasin son practicament desbrombats. Totun, a la fin deu s. XIXau, lo hroment qui èra passat en segond, que va tornar préner lo davant. Lo milhòc, de qui lo sem e vien deus mei bèths cabelhs de la recòlta precedenta, perd en rendament. Au contre, lo hroment que profieita de las recèrcas deus poders publics permor que'u negòci son qu'a ua plaça importanta tà la balança comerciau deu païs.
Lo pan de hroment remplaça lo pan de milhòc o de harias mixtas. De nhaute costat, l’exòde rurau indusit per la revolucion industriau, tira au milhòc, ua bona part de la man d’òbra qui'u hè grana hrèita. Dinc a mieitat deu s. XXau, lo milhòc torna estar ua cultura familiau qui n'ei pas mei practicada que sus 300 000 ha.
En octobre de 1930, s’abreih a Pau lo purmèr congrès internacionau deu milhòc qui hè entrar en França las recèrcas geneticas qui van tornar lançar la cultura soa, notablament hens la region nosta. Qu'ei decidit de crear en Biarn ua estacion experimentau de qui la crampa d’agricultura deus Pirinèus-Baishs que va assegurar la gestion. Qu’ei finalament a St-Martin-de-Hinx que serà apitada. Los islòts de milhòc-semença que hèn pro lèu la loa aparicion. L'estacion serà estacada a l’INRA en 1946. En 1934, qu'ei apitada l’Associacion Generau deus Productors de Milhòc (AGPM) e en 1936, la « Coop de Pau » qui va har vàder lo grop « Euralis ». Las mòdas de cultura cambian radicalament cap la fin de las annadas cinquanta, dab l’adopcion deus milhòcs ibrides, la generalisacion deus engrèishs e la democratizacion deus tractors. La superficia cultivada qu'ei multiplicada per cinq. La plana de Nai que l'ei quasi tota consacrada...
Le maïs semble avoir été domestiqué il y a 9 000 ans dans la Sierra Madre del Sur, au Sud de Mexico. Il arrive en Europe au XVI°s. Avec les conquistadors, et est planté d’abord dans la région andalouse. Grâce à des analyses génétiques, on a déterminé que le maïs cultivé de la Galice aux Pyrénées vient d’une combinaison des maïs d’Amérique du Sud et du Nord. Il est amené dans le Sud-Ouest par les ports de Bayonne et Bordeaux (Il est mentionné à Bayonne en 1523 et à Monein en 1675).
Peu utilisé au XVIes., sa culture se répand au siècle suivant et atteint son apogée vers 1850. Elle occupe alors 650 000 ha en France et, comme le confirme l’intendant d’Étigny, le maïs béarnais est exporté par le col du Somport, en Espagne et au Portugal. Dans les Landes et les Basses-Pyrénées, les surfaces doublent de 1800 à 1850 et le seigle, le millet, le sarrasin sont pratiquement oubliés. Toutefois, à la fin du XIXe s., le blé qui était passé au second plan, va reprendre les devants. Le maïs, dont la semence vient des plus beaux épis de la récolte précédente, perd en rendement. Par contre, le blé profite des recherches des pouvoirs publics car son commerce a une place importante pour la balance commerciale du pays.
Le pain de froment remplace le pain de maïs ou de farines mixtes. D’autre part, l’exode rural induit par la révolution industrielle, enlève au maïs, une bonne part de la main d’œuvre dont il est plus friand. Jusqu’à la moitié du XXe s., le maïs redevient une culture familiale qui ne se pratique plus que sur 300 000 ha.
En octobre 1930, s’ouvre à Pau le premier congrès international du maïs qui introduit en France les recherches génétiques qui vont relancer sa culture, notamment dans notre région. Il est décidé de créer en Béarn une station expérimentale dont la chambre d’agriculture des Basses-Pyrénées va assurer la gestion. C’est finalement à St-Martin-de-Hinx qu’elle verra le jour. Les îlots de maïs-semence font bientôt leur apparition. La station sera rattachée à l’INRA en 1946. En 1934, est créée l’Association Générale des Producteurs de Maïs (AGPM) et en 1936, la « Coop de Pau » qui donne naissance au groupe « Euralis ». Les modes de culture changent radicalement vers la fin des années cinquante, avec l’adoption des maïs hybrides, la généralisation des engrais et la démocratisation des tracteurs. La superficie cultivée est multipliée par cinq. La plaine de Nay lui est presque entièrement consacrée...
Cultura tradicionau - Culture traditionnelle
A la debuta deu sègle darrèr, en Bearn, que hèn tornar las culturas de milhòc e blat o enqüèra milhòc, blat e trèu. Mes sus las tèrras las mes favorablas, la cereala que pòt estat cultivada dinc a cinq o sheis ans de seguir. Qu'emplegan generaument lo hems mes daubuns agricultors començan a utilizar la potassa e l’azòt. Tots los quate o cinq ans, que caucean los camps.
Las tèrras que son lauradas hèra pregond e arrascladas mei d'un còp. Que passan la trilha e, de miei-abriu dinc a junh, lo milhòc qu'ei semiat a la man (mei tard, au semiader) e au carrat, a 60 cm en tots sens, dab los mes bèths deus grans deus mes bèths cabelhs de la recòlta passada. Que'u hè hrèita ua man d’òbra nombrósa. Lo gran gèrma en 6 a 12 dias. Que hèn dus binatges a un dotzenat de dias d’intervalle, qu'esclareishen e que sarclan. Quan los milhoquets que hèn près d’un mètre, que passan lo hossèr e que butan tà en.hortir los pès en cas de vent.
Lo milhòc troba sa talha maximala cap la fin de julhet. Las flors masclas e fumèlas que's desvolopan tà balhar un a tres cabelhs. Lo cap comença lavetz a estadí's e dessecà's. Lo temps d’esbecar qu'ei viengut. Lo còth protegit per un carrat, tad esvitar las talhucadas de las huelhas trencadissas, que cau tirar la partida de la cama au sus deu cabelh lo mei haut. Los becs que serveishen de pastura.
Que cuelhan lo milhòc de fin seteme a noveme. Que destacan, a la man, los cabelhs dab la peròca, que'n emplian la loa tista que la se vueitan hens un car, en cap de camp. Los bueus l’amian devath la bòrda on se hèn granas pièlas que calerà esperocar.
Vesins e amics que's juntan a la familha, a la velhada, tà l'esperoquèra. Que s’assedeishen en aròu a l'entorn d'un pialòt e que destacan la peròca deu cabelh dab un esperocader de husta o de hèr religat au punhet de la man dreta per un cordilhon. Los cabelhs desnudats que son hicats en sacs que pujan au solèr e que barrejan suu sòu. De temps en quan, sustot a la debuta, que cau mautar la pièla de cabelhs taus empachà'us d'eslorí's. Los solèrs, tad ua mei bona aeracion, qu'avèn sovent un penon de taulas desjuntadas, e lhèu un taulòt de clara lutz.
La desquilhada tradicionau a la man, que's hè sovent lo ser, au corn deu huec, a mesura de las hrèitas. Asseduts suu banc o ua cadiera baisha, que freitan lo cabelh contre ua barra de hèr passada devath lo cuu entà la cotar e que recuelhen lo gran hens ua bacina o ua tista a larga alandada.
Au début du siècle dernier, en Béarn, on assole les cultures maïs et blé ou encore maïs, blé et trèfle. Mais sur les terrains les plus favorables, la céréale peut être cultivée jusqu’à cinq ou six ans de suite. On emploie généralement le fumier mais certains agriculteurs commencent à utiliser la potasse et l’azote. Tous les quatre ou cinq ans, on chaule les champs.
Les terres sont labourées très profond et hersées plusieurs fois. On passe le rouleau et, de la mi-avril à juin, le maïs est semé à la main (plus tard, au semoir) et au carré, à 60 cm en tous sens, avec les plus beaux grains des plus beaux épis de la récolte passée. Il nécessite une main d’œuvre nombreuse. Le grain germe en 6 à 12 jours. On effectue deux binages à une douzaine de jours d’intervalle, on éclaircit et on sarcle. Lorsque les plants font près d’un mètre, on passe la houe et on butte pour renforcer les pieds en cas de vent.
Le maïs atteint sa taille maximale vers la fin juillet. Les fleurs mâles et femelles se développent pour donner un à trois épis. La tête commence alors à flétrir et se dessécher. Le temps d’écimer est venu. Le cou protégé d’un foulard, pour éviter les coupures des feuilles tranchantes, il s’agit d’ôter la partie de la tige au-dessus de l’épi le plus haut. Les cimes servent de fourrage.
On récolte le maïs de fin septembre à novembre. On détache, à la main, les épis avec leurs spathes, on en remplit son panier qu’on vide dans un char, en bout de champ. Les bœufs l’amènent sous la grange où l’on fait de grand tas qu’il faudra dépouiller. Voisins et amis se joignent à la famille, à la veillée, pour l'effeuillage du maïs. On s’assied en rond autour du tas et on détache les spathes de l’épi à l’aide d’un poinçon de bois ou de fer relié au poignet de la main droite par un cordon. Les épis dénudés sont mis en sacs qu’on monte au grenier et qu’on déverse à même le plancher. De temps en temps, surtout au début, il faut remuer le tas d’épis pour les empêcher de moisir. Les greniers, pour une meilleure aération, avaient souvent un pignon de planches disjointes, voire un plancher à claire-voie.
L’égrenage traditionnel à la main, se fait souvent le soir, au coin du feu, au fur et à mesure des besoins. Assis sur un banc ou une chaise basse, on frotte l’épi contre une barre de fer qu’on a enfilée sous son derrière pour la caler et on recueille le grain dans une bassine ou un panier à large ouverture.